Phytothérapie : définition, principes et utilisation
La phytothérapie, médecine ancestrale qui utilise les vertus des plantes pour apaiser et favoriser le bien-être, connaît un regain d'intérêt face aux limites de la médecine conventionnelle.
Alliant tradition et modernité, cette approche naturelle s’appuie sur les principes actifs des végétaux, tout en considérant la plante dans sa globalité et son interaction avec l’organisme. Si son efficacité est aujourd’hui prouvée scientifiquement pour de nombreux troubles, la phytothérapie nécessite cependant un encadrement par des professionnels formés, afin de garantir une utilisation sûre et adaptée, en synergie avec les traitements classiques.
Sommaire :
1- Qu’est-ce que la phytothérapie ?
2- Histoire et évolution de la phytothérapie
3- Principes actifs et formes d’utilisation
4- Applications thérapeutiques
5- Précautions d’emploi et effets indésirables
Qu’est-ce que la phytothérapie ?
Définition et principes de base
La phytothérapie, du grec « phytos » signifiant plante et « therapeia » signifiant traitement, désigne l’utilisation des plantes et des extraits végétaux à des fins thérapeutiques. Cette médecine ancestrale repose sur les propriétés pharmacologiques des molécules bioactives naturellement présentes dans les végétaux.
Cependant, la phytothérapie ne se résume pas à exploiter des principes actifs isolés. Son approche consiste à utiliser la plante dans sa globalité, ce que l’on nomme le « totum », c’est-à-dire l’ensemble des composés qui agissent en synergie. Ce mode d’action différencie la phytothérapie de l’allopathie qui emploie des molécules extraites ou de synthèse.
Ainsi, la phytothérapie s’appuie sur une vision holistique, considérant que l’effet thérapeutique provient de l’action combinée et harmonieuse des différents constituants d’une plante. Cette approche permet une action plus douce et progressive, en stimulant les capacités d’auto-guérison de l’organisme, tout en limitant les effets secondaires.
Différences avec l’herboristerie et l’allopathie
Comme le note Jean Bruneton dans son ouvrage « Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales » :
La phytothérapie utilise des méthodes modernes d’extraction des principes actifs et valide leurs propriétés par une approche scientifique
Cela la distingue de l’herboristerie traditionnelle basée sur un savoir empirique des plantes utilisées dans leur intégralité. L’allopathie se concentre sur des molécules végétales isolées, modifiées chimiquement ou synthétisées, et destinées à soulager des symptômes spécifiques.
Histoire et évolution de la phytothérapie
Des origines anciennes à la médecine moderne
L’utilisation des plantes médicinales remonte aux origines de l’humanité. Les sumériens, 3000 ans av. J.-C., utilisaient déjà des décoctions de plantes comme le myrte ou le thym pour soigner. Le papyrus Ebers, datant du XVIe siècle av. J.-C., est le premier recueil connu consacré aux plantes médicinales.
Dans l’Antiquité, les Grecs avec Hippocrate, Dioscoride et Galien, puis les Romains avec Pline l’Ancien, ont approfondi et transmis ce savoir ancestral. Au Moyen-Âge, les médecins arabes comme Avicenne et l’école de Salerne en Italie ont perpétué cet héritage.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’essor de la chimie permet d’extraire les principes actifs des plantes comme la morphine, la quinine ou l’aspirine.
Regain d’intérêt et recherches actuelles
Depuis les années 1970, la phytothérapie connaît un nouvel essor. Le public se tourne à nouveau vers cette médecine naturelle, en quête d’alternatives aux traitements conventionnels et de moyens de prévention doux.
Ce regain de popularité a poussé la communauté scientifique à entreprendre de nouvelles recherches pour mieux comprendre les mécanismes d’action des plantes médicinales. Des organismes comme l’OMS et la Commission E européenne ont été créés afin de recenser les usages traditionnels, les valider et établir des standards de qualité et de sécurité.
Aujourd’hui, de nombreuses études cliniques sont menées pour évaluer l’efficacité des préparations à base de plantes. Elles visent à identifier précisément les principes actifs, déterminer les doses optimales et s’assurer de l’innocuité des traitements. Bien que des progrès restent à faire, ces travaux ouvrent la voie à une phytothérapie modernisée, alliant le meilleur de la tradition et de la science.
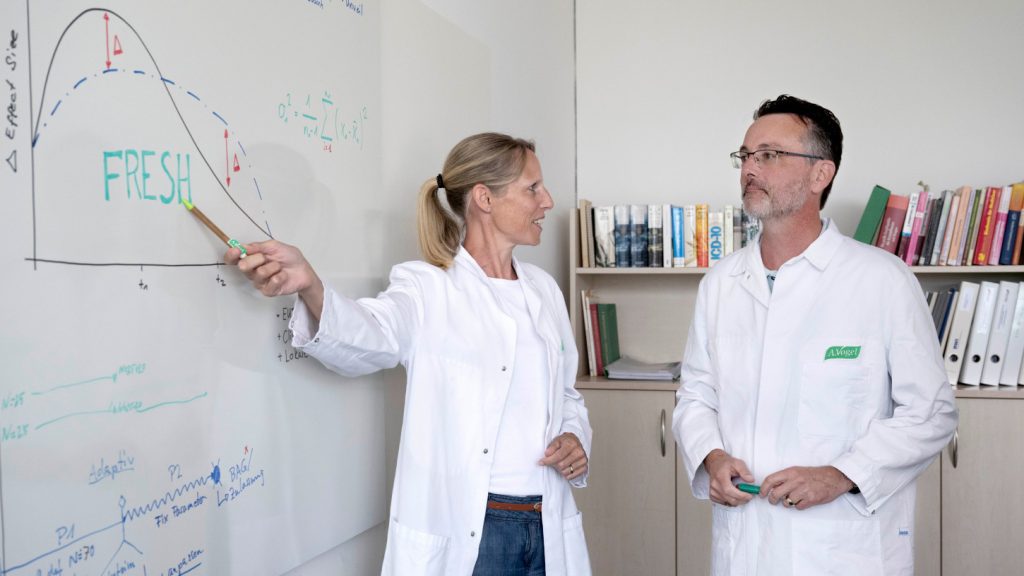
Principes actifs et formes d’utilisation
Principaux composés bioactifs des plantes
Les plantes médicinales contiennent une variété de composés bioactifs qui leur confèrent leurs propriétés thérapeutiques :
- Les alcaloïdes, molécules azotées aux effets puissants comme la morphine, la quinine ou la caféine.
- Les flavonoïdes, pigments antioxydants aux nombreuses vertus : anti-inflammatoires, protecteurs vasculaires, etc.
- Les tanins, composés astringents et cicatrisants présents dans de nombreuses écorces.
- Les saponosides ou saponines aux propriétés tensioactives, expectorantes et immunostimulantes.
- Les huiles essentielles, mélanges de molécules aromatiques concentrées utilisées notamment en aromathérapie.
Chaque famille de composés agit de manière spécifique et synergique, expliquant la polyvalence de la phytothérapie. Leur concentration varie selon la partie de la plante utilisée (racines, feuilles, fleurs, etc) et la forme galénique choisie (infusion, extrait, poudre…).
Formes galéniques et modes d’administration
En phytothérapie, les plantes médicinales peuvent être utilisées sous différentes formes galéniques, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients :
- Les tisanes : simples à préparer par infusion ou décoction, elles permettent une absorption rapide des principes actifs hydrosolubles. Cependant, leur goût peut être désagréable et la conservation est limitée.
- Les gélules : pratiques à avaler, elles protègent les composés thermosensibles et masquent le goût. Mais l’absorption est plus lente et il faut veiller à la qualité des extraits.
- Les teintures : très concentrées, quelques gouttes suffisent. L’alcool optimise l’extraction des principes actifs. . Sans contre-indication excepté chez les personnes qui ont des troubles ou une addiction liés à l’alcool.
- Les sirops : agréables au goût, ils sont bien tolérés, notamment chez l’enfant. Il faut néanmoins tenir compte de leur teneur en sucre et pour certains leur teneur en alcool.
- Les pommades ou crèmes : appliquées localement, elles agissent directement sur les tissus. Le choix de la forme (crème, gel, huile) dépendra du problème à traiter.
Le mode d’administration choisi influencera la façon dont l’organisme absorbe et utilise les principes actifs d’une plante médicinale ainsi que la rapidité d’action des principes actifs. Le choix de la forme galénique dépendra aussi des préférences et des contraintes des utilisateurs. En effet, certains préfèrent le goût agréable des sirops, tandis que d’autres ont des difficultés à avaler des comprimés en raison de problèmes de santé. Il est donc recommandé de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien pour déterminer quelle forme sera la plus adaptée à sa situation personnelle.
L’importance du totum de la plante
La plante entière renferme une multitude de composés qui agissent en synergie. Cette action combinée et harmonieuse des différents constituants végétaux est appelée le « totum » de la plante.
Contrairement à l’allopathie qui se concentre sur des molécules isolées, la phytothérapie considère que l’effet thérapeutique optimal provient de cette synergie naturelle des composants. L’utilisation de la plante dans sa globalité permet ainsi une action plus douce, progressive et complète sur l’organisme.
Le totum offre l’avantage d’une efficacité thérapeutique renforcée tout en minimisant les effets secondaires potentiels. C’est pourquoi il est essentiel en phytothérapie de privilégier des préparations à base de plante entière, qui respectent et préservent cet équilibre naturel des principes actifs.
Applications thérapeutiques
Champs d’action de la phytothérapie
La phytothérapie offre des solutions naturelles pour soulager de nombreux troubles du quotidien. Voici ses principaux champs d’action, avec quelques exemples de plantes utilisées :
- Troubles digestifs : la menthe poivrée et la mélisse aident à réduire les ballonnements et les spasmes intestinaux. L’artichaut et le radis noir favorisent la digestion et la fonction hépatique.
- Stress et sommeil : la valériane, la passiflore et l’aubépine sont réputées pour leurs vertus apaisantes et facilitent l’endormissement. La rhodiole aide à mieux gérer le stress.
- Immunité : l’échinacée, le sureau noir et la propolis renforcent les défenses naturelles de l’organisme, surtout en période hivernale.
- Circulation veineuse : la vigne rouge, le marron d’Inde et le cyprès sont recommandés en cas de jambes lourdes ou de varices. Le ginkgo biloba stimule la microcirculation.
- Douleurs articulaires : l’harpagophytum et le cassis sont appréciés pour soulager les rhumatismes et l’arthrose. Le curcuma et le gingembre ont une action anti-inflammatoire intéressante.
En plus de ces indications phares, la phytothérapie peut être utile dans bien d’autres domaines : sphère urinaire, ménopause, peau… Mais son usage requiert l’avis d’un professionnel de santé qui saura vous conseiller les plantes les plus adaptées à votre situation.

Approches préventive et curative
La phytothérapie offre deux approches complémentaires pour prendre soin de soi :
- En prévention : certaines plantes peuvent être utilisées régulièrement pour renforcer les défenses naturelles, soutenir les fonctions de l’organisme et maintenir un bon équilibre. Par exemple, l’échinacée est souvent conseillée en cure avant l’hiver pour stimuler l’immunité.
- En traitement : de nombreuses plantes ont démontré leur efficacité pour soulager les symptômes de troubles courants. Ainsi, en cas de digestion difficile, des plantes comme la menthe poivrée ou le romarin peuvent favoriser le confort digestif. De même, la valériane est traditionnellement utilisée pour ses vertus apaisantes et sédatives en cas de stress ou de sommeil perturbé.
L’idéal est souvent de combiner les deux approches, en choisissant les plantes les plus adaptées à sa situation avec les conseils d’un professionnel de santé.

Limites et complémentarité avec l’allopathie
La phytothérapie offre des solutions naturelles efficaces pour de nombreux troubles du quotidien. Maux digestifs, problèmes de sommeil, fatigue passagère… Les plantes médicinales permettent bien souvent de soulager en douceur ces désagréments, sans effets secondaires.
Cependant, la phytothérapie a ses limites. Pour les maladies graves ou chroniques, elle ne peut se substituer aux traitements conventionnels prescrits par un médecin. Son action est plus douce, plus lente. Dans les situations d’urgence ou les pathologies lourdes, la médecine allopathique reste indispensable.
L’idéal est souvent une complémentarité entre les deux approches. La phytothérapie ne s’oppose pas aux médicaments, elle les complète harmonieusement. En atténuant les effets secondaires, en renforçant l’organisme, en agissant en prévention, les plantes sont de précieuses alliées santé. Mais toujours sous contrôle médical, pour une efficacité et une sécurité optimales.
Précautions d’emploi et effets indésirables
Toxicité et effets secondaires possibles
Si les plantes sont généralement considérées comme inoffensives, elles peuvent néanmoins présenter certains risques. En effet, de nombreux végétaux contiennent des substances actives puissantes pouvant entraîner des effets secondaires.
Certaines plantes connues pour leur toxicité doivent être utilisées avec une grande précaution, voire évitées. C’est le cas par exemple de la belladone, du datura ou de l’aconit qui renferment des alcaloïdes potentiellement dangereux à forte dose. D’autres comme le millepertuis peuvent interagir avec des médicaments et réduire leur efficacité.
Il est donc essentiel de toujours demander l’avis d’un professionnel de santé avant de débuter une cure de plantes, même en vente libre. Un phytothérapeute pourra déterminer les espèces les plus adaptées à votre situation et vous conseiller un dosage optimal pour profiter de leurs bienfaits en toute sécurité.

Interactions médicamenteuses
Certaines plantes médicinales peuvent interagir avec des médicaments conventionnels et modifier leur effet. Le millepertuis, par exemple, peut diminuer l’efficacité de traitements comme la pilule contraceptive, des anticoagulants ou des antidépresseurs. Le ginkgo biloba risque d’augmenter l’effet fluidifiant des anticoagulants et donc le risque de saignement.
Il est donc essentiel d’informer votre médecin ou votre pharmacien de toute prise de plantes, et de demander conseil avant d’associer phytothérapie et médicaments. Leur expertise permettra d’adapter votre traitement pour éviter tout risque d’interaction délétère.
Importance du conseil professionnel
Les plantes médicinales sont de précieuses alliées santé, riches en principes actifs naturels. Elles peuvent nous aider à soulager de nombreux maux du quotidien et renforcer notre organisme.
Cependant, aussi naturelles soient-elles, les plantes ne sont pas dénuées de risques. Certaines contiennent des substances très puissantes, qui mal dosées ou combinées de façon inadaptée, peuvent se révéler toxiques voire dangereuses.
C’est pourquoi il est essentiel, avant toute utilisation de phytothérapie, de demander l’avis éclairé d’un professionnel de santé. Médecin, pharmacien, phytothérapeute diplômé sauront vous guider vers les espèces les plus adaptées à votre situation et vous conseiller un dosage optimal. Leur expertise vous permettra de profiter sereinement des bienfaits des plantes, en toute sécurité.
En définitive, la phytothérapie offre une approche naturelle et globale pour prendre soin de sa santé au quotidien, en s’appuyant sur les vertus des plantes médicinales, tout en considérant la personne dans sa globalité. Véritable pont entre tradition et science moderne, elle permet de soulager en douceur de nombreux maux, grâce à des préparations à base de plantes fraîches de haute qualité.
Depuis 1923, le Laboratoire A.Vogel perpétue cet amour des plantes et cette philosophie du soin, en proposant une large gamme de produits issus de cultures biologiques, pour le bien-être de chacun. Néanmoins, l’usage de la phytothérapie nécessite des conseils avisés de professionnels formés, afin de garantir sécurité et efficacité, en synergie avec les traitements conventionnels si besoin. Car prendre soin de soi au naturel, c’est aussi savoir s’entourer pour être bien accompagné sur le chemin de l’équilibre et de la santé.






